Heures de crise. A la recherche du temps retrouvé

Pierre Allorant, doyen de la faculté de droit d’Orléans et historien
Temps suspendu de la majorité confinée, temps de souffrance des malades et d’angoisse de leurs proches, temps ralenti et vide de sens des personnes âgées privées de visites, temps épuisant et gardes à rallonge des soignants « au front », « en première ligne ». Oui décidément cette crise sanitaire, d’une ampleur et d’une durée inédites au XXIe siècle, nous replonge dans le souvenir des affres qui avaient fort heureusement déserté l’ouest du continent européen depuis 1945.
Si le vocabulaire martial du Président de la République, pas forcément adapté en l’absence d’ennemi palpable, rappelle le fameux « je fais la guerre » de Clemenceau fin 1917, les défis immédiats que pose la pandémie, la situation des « civils » et les réponses à apporter remémorent d’autres périodes de crise, de lois et gouvernement d’exception.
Transports sanitaires, hôpitaux de campagne et rapatriement à l’arrière
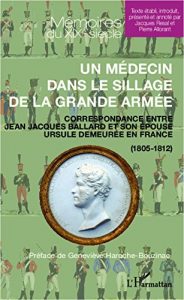
Au-delà de la prouesse technologique et sanitaire, le transport de centaines de malades du Grand Est et de l’Ile-de-France pose question. Le différentiel territorial impressionnant du nombre de cas a-t-il un lien avec le vecteur du virus que serait la pollution industrielle des régions « à l’est de la ligne Saint-Malo-Genève » ? La territorialisation de la politique de santé a-t-elle contribué à combler ou à aggraver les inégalités d’accès aux soins ?
Les transports sanitaires rappellent les guerres les plus meurtrières, la présence de médecins et de chirurgiens dans le sillage de la Grande Armée de Napoléon[1], l’affirmation de La Croix rouge lors de la guerre de Crimée et surtout les premières boucheries de l’été 1914. Dépassé par un carnage impensé par le « plan XVII », l’État-major français décide à la hâte d’utiliser les wagons à bestiaux chargés à l’aller du ravitaillement en pièces de boucherie pour rapatrier en urgence vers le sud-ouest les blessés et mutilés, et soulager ainsi les hôpitaux de campagne…
Démocraties parlementaires en guerre. Contrôler l’exécutif pour surveiller les chefs militaires
Le résultat sanitaire, totalement catastrophique, est l’élément déclencheur qui actionne un réveil du contrôle parlementaire non seulement sur l’exécutif gouvernemental, mais sur les généraux eux-mêmes. L’impéritie, la négligence, l’incompétence de Lyautey puis de Joffre – l’auteur du mot d’ordre faussement rassurant et à tout dire sinistre, « je les grignote » – sont stigmatisées sans relâche au sein du comité de l’Armée du Sénat, et des commission secrètes, par Clemenceau redevenu « tigre », et par son infatigable bras droit Jules Jeanneney, jusqu’à aboutir au remplacement du général, promu maréchal et envoyé en Amérique prêcher la solidarité transatlantique. Mais n’oublions pas la leçon, soulignée par Antoine Prost : si la France et la Grande-Bretagne ont gagné la Grande Guerre, c’est aussi parce qu’elles ont continué le contrôle parlementaire des « experts » militaires et des gouvernements, alors qu’en Allemagne, les généraux prenaient le pouvoir et imposaient au Kaiser la guerre sous-marine à outrance, précipitant les Etats-Unis dans les bras de l’Entente.
Derrière l’urgence, l’amélioration de la prise en charge sanitaire et sociale ?
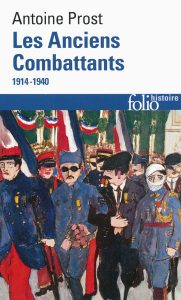 Concrètement, les exigences sanitaires sont relevées, la chaîne des hôpitaux structurée, et des demeures bourgeoises transformées en maisons de convalescence, sous la pression vigilante des associations de blessés et des mutilés de guerre, qui œuvrent à moyen terme pour l’extension des droits de tous à la santé et à l’assistance face aux aléas de la vie, ébauche d’assurances sociales[2]. Parmi les victimes, une difficulté particulière est celle de la reconnaissance de l’invalidité des gazés, victimes de l’Ypérite, dont la détérioration des poumons est souvent peu palpable et lente à entraîner la mort.
Concrètement, les exigences sanitaires sont relevées, la chaîne des hôpitaux structurée, et des demeures bourgeoises transformées en maisons de convalescence, sous la pression vigilante des associations de blessés et des mutilés de guerre, qui œuvrent à moyen terme pour l’extension des droits de tous à la santé et à l’assistance face aux aléas de la vie, ébauche d’assurances sociales[2]. Parmi les victimes, une difficulté particulière est celle de la reconnaissance de l’invalidité des gazés, victimes de l’Ypérite, dont la détérioration des poumons est souvent peu palpable et lente à entraîner la mort.
Les classes et les genres : femmes sur le pied de guerre
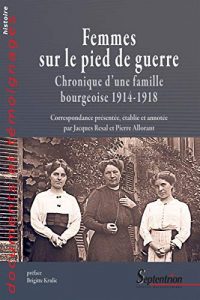 Alors que la Grande Guerre met en contact direct des classes sociales, très compartimentées à la Belle époque, la générosité et le bénévolat soulignent l’importance des divisions sociales. Non pas, à l’inverse d’une idée reçue, que les jeunes bourgeois soient moins victimes de la grande faucheuse : officiers et sous-officiers, cavaliers, aviateurs fournissent un terrible tribut, cette saignée des élites affaiblissant durablement le pays. La guerre, comme le choléra en 1832, la grippe espagnole en 1919 ou le coronavirus en 2020, frappe partout. En revanche, les ouvroirs, les sociétés de soutien aux mères, aux orphelins sont tenus par les « Dames françaises » issues de la haute société, dont les filles deviennent le plus souvent infirmières durant le conflit. Très loin de « l’exode » des beaux quartiers de Paris vers les résidences secondaires atlantiques à la veille du confinement, sans bombardement de stukas et sans transfert du gouvernement à Bordeaux via Tours.
Alors que la Grande Guerre met en contact direct des classes sociales, très compartimentées à la Belle époque, la générosité et le bénévolat soulignent l’importance des divisions sociales. Non pas, à l’inverse d’une idée reçue, que les jeunes bourgeois soient moins victimes de la grande faucheuse : officiers et sous-officiers, cavaliers, aviateurs fournissent un terrible tribut, cette saignée des élites affaiblissant durablement le pays. La guerre, comme le choléra en 1832, la grippe espagnole en 1919 ou le coronavirus en 2020, frappe partout. En revanche, les ouvroirs, les sociétés de soutien aux mères, aux orphelins sont tenus par les « Dames françaises » issues de la haute société, dont les filles deviennent le plus souvent infirmières durant le conflit. Très loin de « l’exode » des beaux quartiers de Paris vers les résidences secondaires atlantiques à la veille du confinement, sans bombardement de stukas et sans transfert du gouvernement à Bordeaux via Tours.
À l’autre extrémité de la société, paysannes et ouvrières sont en 1914-1918 les providentielles « remplaçantes » des époux et frères mobilisés, et surprennent l’opinion, font la Une de la presse au volant des tramways ou en tournant des obus, aux côtés de l’autre main d’œuvre de substitution : les étrangers et les coloniaux. Le tout mobilisé par un État interventionniste et planificateur, incarné par Albert Thomas, associant les acteurs économiques, guidant les productions essentielles à la nation et expérimentant un nouvel échelon d’administration : la région économique, imaginée par l’historien Henri Hauser. Mais, comme hier, il suffit de lire les témoignages des malades et des médecins pour constater que, sur tous les fronts, des caisses d’hypermarché aux hôpitaux, de l’aide-soignante à la cheffe de service, les « héros en blouse blanche » ou bleue – féministation massive des professions de santé oblige – sont majoritairement des femmes[3].
La permission de garder le lien. Lignes de vie
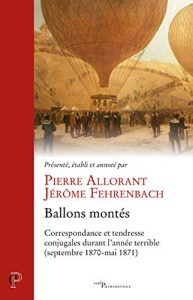 Si les soldats, englués dans la guerre de positions symbolisée par la tranchée, sont figés dans une forme de confinement collectif, « unis comme au front », ils souffrent de la coupure des relations avec « l’Arrière », leurs familles, auxquelles ne les relient que les lignes tracées sur les milliards de cartes postales échangées, puis l’espoir à partir de 1915 de la « permission », ce déconfinement temporaire. Dans une guerre sans fin qui inverse la situation traditionnelle de la guerre de siège où les civils étaient privés de liberté d’aller et venir, comme l’avaient encore vécu les Parisiens sous le siège prussien de « l’Année terrible » à l’hiver 1870-1871, affamés et soumis aux vols des pigeons voyageurs et au décollage aléatoire des ballons montés pour la circulation du courrier[4].
Si les soldats, englués dans la guerre de positions symbolisée par la tranchée, sont figés dans une forme de confinement collectif, « unis comme au front », ils souffrent de la coupure des relations avec « l’Arrière », leurs familles, auxquelles ne les relient que les lignes tracées sur les milliards de cartes postales échangées, puis l’espoir à partir de 1915 de la « permission », ce déconfinement temporaire. Dans une guerre sans fin qui inverse la situation traditionnelle de la guerre de siège où les civils étaient privés de liberté d’aller et venir, comme l’avaient encore vécu les Parisiens sous le siège prussien de « l’Année terrible » à l’hiver 1870-1871, affamés et soumis aux vols des pigeons voyageurs et au décollage aléatoire des ballons montés pour la circulation du courrier[4].
Penser la sortie de crise. « De si beaux lendemains » ?
Économie exsangue, dettes massives, circuits de production et de consommation à repenser, rôle de l’État à redéfinir, secteurs et branches à reconvertir vers la transition environnementale, démocratie en ballotage et modèle éducatif méritocratique ébranlés (des élections municipales étalées de mars à octobre et faisant fi du Code électoral, un bac, l’ancien « brevet de bourgeoisie », réduit à la peau de chagrin du contrôle continu, des concours d’accès aux grandes écoles et de recrutement aux trois fonctions publiques bouleversés) ; une Europe à rebâtir d’urgence sur la solidarité concrète, sauf à disparaître dans le ressentiment des populismes, avivés par des plans de retour à l’équilibre dignes des médecins de Molière – mourir guéris, à l’équilibre budgétaire – et une indifférence suicidaire au désarroi des États méditerranéens, l’Italie et l’Espagne après la Grèce, aussi bien face au drame des réfugiés que face à la pandémie : on a vu des institutions mourir pour moins que cela. Qui se souvient de la fierté d’accueillir, de 1981 à 1986, puis après 1989, les anciennes dictatures devenues démocraties-sœurs ?
Le mouvement des Gilets jaunes avait pu conduire l’an dernier à penser que nous étions en 1788. Et si nous étions plutôt en 1919 ? Certes, sans les millions de jeunes hommes morts aux combats et avec une pandémie qui n’atteint pas le niveau d’hécatombe de la grippe espagnole. Mais en doutant à nouveau qu’il suffise, à défaut de « Corona-bonds », de se contenter d’une affirmation péremptoire à la Gustave Klotz : « L’Allemagne paiera ! »
Pierre Allorant
[1] Jacques Résal et Pierre Allorant, Un médecin dans le sillage de la Grande Armée (1805-1814). Correspondance de Jean-Jacques Ballard avec son épouse Ursule demeurée en France, L’Harmattan, 2013.
[2] Antoine Prost, Les Anciens combattants et la société française (1914-1939). Tome 2 : Sociologie, Presses de Sciences Po, 1977.
[3] Jacques Résal et Pierre Allorant, Femmes sur le pied de guerre. Chronique d’une famille bourgeoise (1914-1918), Septentrion, 2014.
[4] Jérôme Fehrenbach et Pierre Allorant, Ballons montés. Correspondance et tendresse conjugales durant l’Année terrible (septembre 1870-février 1871), Cerf-Patrimoines, 2019.