Auteur d’une douzaine d’ouvrages, donc écrivain confirmé, Patrick Tudoret vient de se voir attribuer, pour la première fois à l’unanimité du jury, le prix des Grands Espaces Maurice Dousset (du nom de l’ancien président du Conseil régional). Créé en 2002 par l’association Maison de la Beauce dans le but d’améliorer le regard que les hommes portent sur l’espace qu’ils traversent, en particulier sur les grands espaces à l’horizon ouvert, notamment sur la plaine de Beauce, ce prix littéraire est doté d’une récompense de 4000 euros.
« L’homme qui fuyait le prix Nobel », le roman récompensé et paru à la fin de 2015 conduit ses lecteurs sur les chemins de Compostelle. Ce grand voyage effectué à pied par Tristan Talberg, écrivain veuf d’une femme adorée, qui vient, contre toute attente, de recevoir le Nobel qu’il fuit est pour ce pèlerin en rupture de ban l’occasion d’une méditation littéraire sur la vanité des gloires humaines, l’éternité de l’amour, la beauté de la nature et le sacré. Cette lente traversée de la France et d’une partie de l’Espagne débouche sur un livre plein de poésie qu’on ouvre pour ne plus le lâcher et que l’on referme, songeur. Nous avons rencontré Patrick Tudoret. Ce Breton Pied-noir a passé son enfance entre la vallée de la Loire, la Bretagne et la Côte d’Azur. Il vit aujourd’hui entre Paris et le Vendômois dans un prieuré dont les fenêtres s’ouvrent d’un côté sur l’immensité beauceronne et de l’autre sur les contours de la vallée du Loir.
Interview
Est-ce une prémonition qui vous a fait écrire ce livre en 2015 ? Bob Dylan, le lauréat du Nobel 2016 fuit, en ce moment sa récompense et le jury du Nobel. Il a des points communs avec votre héros.
Patrick Tudoret : Je reçois en ce moment beaucoup de mails qui évoquent ma prémonition. Les circonstances s’y prêtent. Disons que je comprends Bob Dylan, l’icône de la contre- culture. S’il accepte le Nobel il est mort. Le Nobel un rien « naphtaliné » est le contraire de ce qu’il a toujours prôné et été. Talberg ne fuit pas le Nobel mais l’homme qu’il n’est plus depuis la mort de sa femme. Son métabolisme est durablement transformé par cette mort. Il ne veut que marcher, et seul. En ce qui me concerne je n’ai rien contre les récompenses littéraires. J’ai même eu la chance d’en recevoir deux ou trois et je suis très fier du prix Grands Espaces-Maurice Dousset.
Qui est Tristan Talberg, le héros de votre roman ?
C’est un homme qui préfère le sel de la vie aux honneurs, aux ors du pouvoir, aux vanités diverses qui nous guettent, nous engluent et nous empêchent de le goûter. Je l’ai appelé Tristan puisque la femme dont il est inconsolable s’appelle Iseult. Étymologiquement, je joue beaucoup avec l’onomastique, Talberg en allemand veut dire vallée/montagne, monts et vaux et cette oscillation est celle de la vie, un instantanée de l’être humain.
Talberg est un écrivain, vous aussi et tout écrivain est dans son livre. Talberg est-il votre alter ego ?
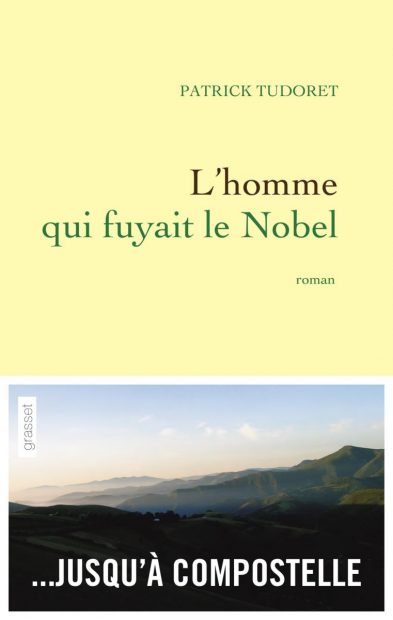 Tout écrivain est dans chacun de ses livres, enfin plus ou moins. Talberg est à la fois proche et loin de moi. Il est plus âgé que moi et je ne suis pas le misanthrope, a priori incurable, qu’il est au début du livre, même si mon regard sur ce monde chaotique, bavard, enflé de son propre vide, dont la plus grande partie fabrique du nihilisme, rejoint le sien. Il est peut-être la part de moi que je récuse avec force, cette tentation de la désillusion qui guette tout être lucide.
Tout écrivain est dans chacun de ses livres, enfin plus ou moins. Talberg est à la fois proche et loin de moi. Il est plus âgé que moi et je ne suis pas le misanthrope, a priori incurable, qu’il est au début du livre, même si mon regard sur ce monde chaotique, bavard, enflé de son propre vide, dont la plus grande partie fabrique du nihilisme, rejoint le sien. Il est peut-être la part de moi que je récuse avec force, cette tentation de la désillusion qui guette tout être lucide.
Je suis comme lui, grave à certains moments, léger à d’autres. « La pesanteur et la grâce », entre ces deux pôles irréconciliables, nos vies s’épuisent en oscillations paniques, fragiles et désemparées. L’humour est l’un des rares antidotes au tragique, je ne puis pas imaginer une vie sans ce recours-là. Le monde crève de l’esprit de sérieux, j’essaye de m’en dégager et l’humour est un bon moyen pour y parvenir.
Dans ce roman les chapitres alternent avec des lettres adressées à la défunte aimée. De cette technique résulte une complémentarité légère. Pourquoi l’avez-vous choisie ?
Avec les lettres, j’ai souhaité rendre hommage à une forme classique que j’aime. Cette double technique m’a donné une liberté doublée de perceptions, de points de vue. C’était comme si j’avais eu à ma disposition de deux caméras portant chacune un regard différent sur le monde. J’ai retenu et mis en application la leçon de Nabokov, immense écrivain doublé d’un grand professeur de littérature: un livre, et à plus forte raison un roman c’est «une structure et un style ». Le langage est au cœur de l’objet. Je suis très attentif au style qui crée le fond, qui le sort de l’informe pour lui donner une forme. Dans la langue française, les synonymes n’existent pas, aussi je cherche à exprimer les sentiments avec le mot le plus juste, celui qui est au plus près. Je déplore l’inculture ambiante qui se traduit par un abandon de notre langue.
Pourquoi envoyer votre héros à Compostelle ? Vous auriez pu le faire marcher vers d’autres horizons.
Je suis encore un jacquet contrarié, manquant de temps pour aller au bout du chemin, mais je connais beaucoup de lieux que je décris pour les avoir fréquentés. Je connais très bien la France et je l’ai faite découvrir à ma femme, petit à petit, région par région. Compostelle, c’est une vieille fascination qui remonte à l’enfance, à mon goût pour l’histoire. Aujourd’hui, c’est avant tout un élan, une soif profonde d’élévation, y compris spirituelle. Pour moi, pour faire échec au vide qui nous guette, il existe trois armes, l’art, l’amour et le sacré.
Comme Talberg je suis un assez bon marcheur. Je n’aime pas les assis, ils m’ennuient. Je n’aime pas ceux qui courent, ils me fatiguent. J’aime ceux qui marchent. Mon roman est un éloge du mouvement, donc de la vie.
Propos recueillis par Françoise Caries